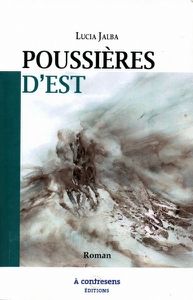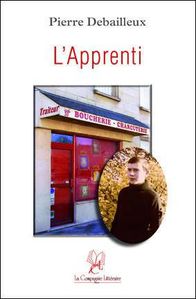Au pied de la lettre, le Festival du livre de Thourotte (60) qui célébrait ses vingt ans cette année sur le thème des "racines", s'est terminé le dimanche 17 mars 2013, par un Salon du livre au sein du complexe Édouard Pinchon. Une quinzaine d'auteurs de littérature jeunesse, BD, littérature générale et trois éditeurs ont présenté leurs livres à un public familial, au cours d'une après-midi ponctuée par plusieurs animations.

Françoise Detraux a proposé une séance de Kamishibaï (théâtre portable en bois, d'origine japonaise) à partir des livres jeunesse d'À Contresens Éditions. Sophie Clerfayt, conteuse d'origine belge, a évoqué son plat pays dans Du côté de chez moi. Deux lectures musicales de Putain d'usine (Jean-Pierre Levaray) et Poussières d'Est (Lucia Jalba) ont également été données par des comédiens, en présence des auteurs.
Au cours de ce salon, j'ai eu le plaisir d'animer un débat sur "Les racines" avec
Lucia Jalba : Née en Roumanie, elle était adolescente sous la dictature de Ceausescu. Elle a travaillé en tant que journaliste. Aujourd'hui professeur documentaliste en Picardie, elle a publié Poussières d'Est (À Contresens Ed.) en 2012.
Abdelkader Railane : Directeur de Mission Locale en Haute-Loire et représentant départemental de la COPEC (Commission pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté). Il a écrit un roman intitulé En pleine face (Ed. Ex Aequo) inspiré de sa propre histoire.
Pierre Debailleux : Habitant de Thourotte et retraité de l'usine Saint-Gobain. Il a publié à compte d'auteur un témoignage appelé L'Apprenti (La Compagnie littéraire).
Jean-Pierre Levaray : Ouvrier au sein de l'usine chimique GPN, dans la banlieue de Rouen. Il a commencé à écrire avec Putain d'usine (Ed. Agone) en 2000.
Pierre Outteryck : Professeur agrégé d’Histoire à Lille. Écrivain passionné par le mouvement ouvrier.Les racines culturelles, les origines
Dans un premier temps, nous avons abordé la question des racines culturelles et des origines avec Lucia Jalba et Abdelkader Railane. Dans Poussières d'Est, les questions du déracinement et de l'appartenance à un territoire sont centrales. Le personnage d'Horia Gherasim, journaliste entre Paris et la Roumanie, explique : "je pourrais affirmer avec une certitude analytique que je ne sais toujours pas à quoi j'appartiens, ni à quel pays, ni à quelle histoire."
Lucide et révolté, il est "tourmenté par la problématique identitaire du nouvel Européen". La Roumanie est entrée dans l'Union européenne en 2007. Ses frontières datent seulement du 20ème siècle, elle est issue du regroupement (artificiel ?) de trois territoires qui ont subi des influences diverses. "Comment se reconnaître dans de telles frontières, imposées aux populations par des pouvoirs administratifs ou politiques" interroge Lucia Jalba ? C'est toute la problématique des Balkans.
Comment admettre en outre que "depuis que la Roumanie est dans la Communauté européenne, les paysans et les Tziganes représentent la honte pour la plupart de la population roumaine" ? La paysannerie est associée au passé et à ses archaïsmes, on s'en détourne aujourd'hui. Les chevaux aussi, dont on a généralisé l'abattage avec la motorisation de l'agriculture (jusqu'au gigantesque scandale alimentaire que l'on connaît...) Quant aux Roms, Lucia rappelle qu'ils furent les esclaves des Roumains, à leur arrivée en Europe (aux 14 et 15èmes siècles). La question de leur rejet, qui agite aussi la France, est loin d'être réglée.
Lorsqu'on évoque les racines d'un individu, la langue en fait partie bien sûr, comme élément fondamental. Le choix d'écrire en français fut-il une évidence pour notre auteur ? "Oui, dit-elle, cette langue me permet de tenir les émotions à distance. Elle est propice à l'expression de la pensée." À la question de savoir si elle se sent toujours d'ailleurs, Lucia nous répond que non : elle a le sentiment de "prendre racine" en Picardie.
Chez Abdelkader Railane, la question des racines est abordée sous le prisme de la double culture. Dans son livre, En pleine face (Ed. Ex Aequo), le héros et narrateur est un garçon de 14 ans dont les parents sont nés en Algérie. Il grandit en France dans une cité HLM près de Douai (59), avec la certitude d'être de passage : "nos parents nous rappelaient tout le temps que nous n'étions pas dans notre pays, que notre patrie c'était l'Algérie." Les immigrés de la première génération sont venus afin de travailler et de gagner assez d'argent pour s'offrir une vie meilleure et rentrer chez eux. Il était donc difficile pour leurs enfants, de s'enraciner dans un pays qu'il faudrait quitter bientôt.
Dans son livre, Abdelkader montre bien qu'au sein des cités pluri-culturelles, le racisme est partout, et dans tous les sens : les Français envers les immigrés et réciproquement, les immigrés algériens envers les harkis ou les juifs. Cette haine repose avant tout, sur une parfaite méconnaissance de l'autre.
L'ignorance, qu'elle soit culturelle, religieuse ou historique, fait des dégâts considérables dans les quartiers. Abdelkader Railane nous explique, que si on lui avait raconté enfant - à l'école ou ailleurs - que ses ancêtres étaient concernés par la Première Guerre mondiale, il aurait réagi différemment lors des cérémonies de commémoration du 11 novembre, dont il avait tendance à se moquer. Quant à la Guerre d'Algérie, c'était un sujet tabou à la maison. Les cours d'Histoire ne l'évoquaient pas non plus. Les enfants de l'immigration algérienne ont dû se construire autour de ce silence.
"C'est bizarre on est constamment en train de critiquer ce pays, mais on refuse de le quitter. Voilà ce dont je me rends compte au fur et à mesure que je grandis" constate le jeune héros du livre. L'attachement à la France, bien qu'y étant né, ne fut pas inné pour Abdelkader, mais acquis avec le temps. "À la maison, on était en Algérie. Quand je sortais de chez moi, j'étais en France. Il me fallait presque un passeport pour passer d'un côté à l'autre !" plaisante-t-il. Peu à peu, grâce à la découverte et à la pratique de la boxe qui lui ouvre de nouveaux horizons, l'adolescent du livre - double fictionnel de l'auteur - parvient à se sentir chez lui en France.
Pour Abdelkader Railane, la double culture a des allures de vinaigrette : "mon vinaigre, c'est l'Algérien qui est en moi, il bouillonne, il cherche sa reconnaissance, il irrite, il veut qu'on lui donne sa place, il est mal dans sa peau, il veut partager sa différence. Mon huile, c'est le Français qui séjourne dans mon esprit, il est calme, reposé, il s'assoit au bord des lois de la République, il est pondéré et surtout il repose sur un socle solide, le droit du sol." Avec le temps, il a réussi à en trouver le bon "dosage". Sans renier ses racines ou son histoire personnelle, il s'est conformé au mode de vie de son pays (le pays d'accueil de ses parents), dans le respect de la République, et de la laïcité.

Le travail : le monde ouvrier et les racines industrielles
La culture et les origines fondent les individus, mais le travail a aussi une importance capitale dans ce domaine. Dans ce débat, nous nous sommes intéressés au monde ouvrier et aux racines industrielles de la France. À Thourotte par exemple, l'histoire de la ville est étroitement liée à celle de l'usine Saint-Gobain, implantée en 1919.
C'est dans cette usine que Pierre Debailleux a travaillé durant 35 ans. Mais avec son livre, L'Apprenti (La Compagnie Littéraire), il témoigne d'une expérience professionnelle précédent la verrerie : cinq années d'apprentissage et de travail, dans le domaine de la boucherie.
Pierre Debailleux ne se prétend pas écrivain, il a voulu rendre hommage à ses employeurs de l'époque et laisser une trace de ces années qui l'ont profondément marqué. Il avait 14 ans à peine, cet apprentissage s'inscrivait dans la continuité de l'éducation qu'il avait reçue à la maison : "Mes parents et mes patrons parlaient le même langage, tout cela pour mon bien. Aujourd’hui, tout le monde espère que l'autre fera le nécessaire. Certains parents ont capitulé face à la remise en question ou le droit chemin." Sans être nostalgique dit-il, il évoque avec émotion le respect réciproque entre patrons et employés, ce "deal" qui consistait pour les premiers à transmettre un savoir, et pour les seconds à avoir en retour le souci du travail bien fait.
Cet environnement professionnel enrichissant est loin de celui que décrit Jean-Pierre Levaray dès son premier livre, Putain d'usine (Ed. Agone), en 2000-2001. Ouvrier dans une usine chimique du groupe Total depuis plus de 30 ans, il a pris la plume parce que ses lectures sur la question lui semblaient éloignées de ce qu'il vivait au quotidien. "Personne n'en parle. Pas porteur. Les syndicats le cachent, les patrons en profitent, les sociologues d'entreprise ne s'y intéressent pas : les prolos ne sont pas vendeurs."
Son ouvrage commence avec le récit, sur un ton désabusé, des accidents graves voire mortels qui émaillent la vie de l'usine. "L'usine, c'est la mort". Nous sommes en 2000, dans une société plutôt à cheval sur les règlements et la sécurité, on a du mal à imaginer que l'on meurt encore autant au travail. Et pourtant, Pierre Outteryck insiste sur cette réalité. On y meurt d'accidents, de maladies professionnelles, de suicides, et on meurt également autour des usines à cause des pollutions. L'historien dénonce avec force les atteintes au droit du travail (l'actuel accord national interprofessionnel de sécurisation de l'emploi, notamment) et l'insécurité croissante dans laquelle les ouvriers doivent travailler.
Notre pays a connu une première vague de désindustrialisation suite au choc pétrolier de 1973. La mondialisation et la compétition internationale ont bouleversé la donne. Une deuxième vague est en cours depuis 2002, avec la suppression de 500 000 emplois en 10 ans. La recherche du profit absolu que dénonce Jean-Pierre Levaray, les réductions de la masse salariale, la sous-traitance généralisée... aggravent les conditions de travail. La finance a pris le pas sur la production. Les dirigeants n'investissent plus dans leur outil. "On en arrive à souhaiter que la boîte ferme. Oui, qu'elle délocalise, qu'elle restructure, qu'elle augmente sa productivité, qu'elle baisse ses coûts fixes. […] On sait que ça va arriver, on s'y attend. Comme pour le textile, les fonderies... Un jour, l'industrie chimique lourde n'aura plus le droit de cité en Europe" écrit-il.
Mais dans Putain d'usine, ce sont moins les conditions de travail dégradées qui préoccupent Jean-Pierre Levaray, que ce "quotidien qui tue", cette "vie bouffée" à répéter les mêmes gestes, à vivre des rythmes décalés, à subir "un boulot mortifère, aliénant et inintéressant." Depuis les années 80, on vide le travail de son essence, selon lui. Pierre Debailleux insiste sur le fait que les ouvriers ne sont pas obligés de choisir ce métier. C'est tout le paradoxe décrit dans le livre. Certes il y a le chômage, et la peur du lendemain, mais pourquoi ne pas tenter de vivre autre chose ? Pour Jean-Pierre Levaray, ces hommes sont tenus par l'argent. "La révolution industrielle a fait de nous des salariés, et parce qu'il y avait la sécurité de ce salaire qui tombe tous les mois en échange de notre force de travail, on s'est fait avoir."
Face à toutes ces difficultés, "chacun tente de s'en sortir individuellement. La lutte collective semble hors de propos." Pourtant militant syndical, Jean-Pierre Levaray constate que "le syndicalisme est un outil dont on a besoin au quotidien sur son lieu de travail, mais il n’est plus que très rarement un instrument de combat. Il est un moyen d’accompagnement pour que les choses soient moins pires à vivre. En même temps, ne remettant pas en cause l’entreprise, il sert à accompagner le système." Pierre Outteryck est moins résigné. Il rappelle que le mouvement ouvrier et les grandes luttes syndicales ont permis d'améliorer les conditions de travail des ouvriers à travers l'histoire.
Mais nous vivons aujourd'hui dans une économie mondialisée où l'on délocalise les usines. Quand certains ouvriers français perdent leur emploi, d'autres dans le monde peuvent en bénéficier. Comment fédérer une classe ouvrière internationale dans ces conditions ? Lucia Jalba évoque le cas de l'usine Dacia du groupe Renault en 2008. Lorsque les salariés roumains se sont mis en grève pour demander des augmentations de salaires, ils ont été soutenus financièrement par les ouvriers français.
Pierre Outteryck croit que ce type d'actions peut être une réponse. Pour Jean-Pierre Levaray, il faudrait que les gens prennent conscience que la lutte collective est là pour servir les intérêts de chacun. Il veut espérer : "militant « engagé dans le social » - et qui plus est libertaire -, je veux encore rêver qu'on se batte pour un monde sans classes, ni État, une société sans salariat, où l'on réfléchirait sur la consommation et la production, sur la façon de travailler". Comment organiser une telle société ? "D'abord on arrête tout, et ensuite : on réfléchit ensemble ! "
En fin de débat, à la question de savoir si l'attachement aux racines, aux origines, est une force ou un frein lorsqu'il s'agit de se tourner vers l'avenir et d'aller de l'avant, les cinq invités semblent adhérer aux propos d'Olivier Weber, écrivain et grand reporter :
"S'attacher à un lieu, se souvenir de ses racines,
retrouver dans une halte les ingrédients de la grande recette, celle des origines.
Et puis s'arracher, repartir,
avec des regards à la fois devant et derrière
comme un métronome obstiné."
(Je suis de nulle part, Sur les traces d'Ella Maillart)
Ce débat était diffusé en direct sur l'antenne de Radio Graf'Hit (94.9 à Compiègne) dans le cadre de l'émission Culture prohibée. L'émission est disponible à l'écoute ICI.